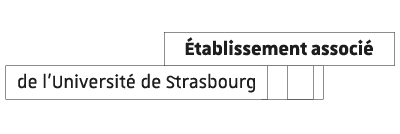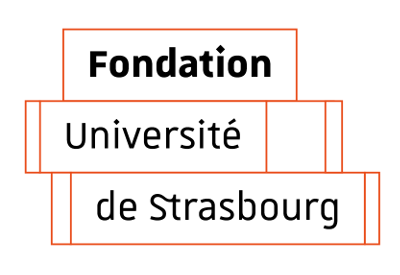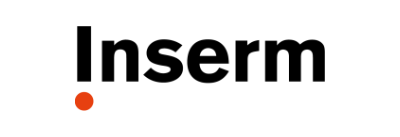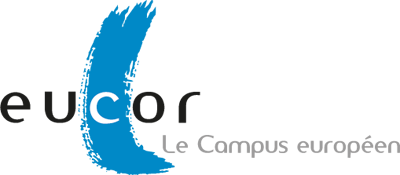06/05/21
Droit, économie et gestion
Le 8 avril dernier, la Cour européenne des droits de l’homme, qui statuait sur la vaccination des enfants en République tchèque après avoir été saisie en 2013 et en 2015, a rendu un arrêt sur un sujet jusque-là inexploité dans sa jurisprudence : la question de la légitimité de l’obligation vaccinale chez les jeunes enfants.
Certains médias n’ont alors pas hésité à titrer : « La CEDH juge la vaccination obligatoire nécessaire dans une société démocratique. »
De là à penser que la Cour appelait, depuis son siège strasbourgeois, à rendre obligatoire la vaccination contre la Covid en Europe, il n’y avait qu’un pas, allègrement franchi dans certains commentaires.
C’est faire sûrement trop cas du contexte qui entourait l’affaire et risquer de manquer les apports pourtant majeurs de cet arrêt.
L’obligation vaccinale n’est pas le modèle dominant en Europe
La République tchèque est l’un de ces rares États européens, à l’instar de la France, de la Pologne ou de la Slovaquie, à avoir adopté une politique très stricte de vaccination des jeunes enfants, sous la forme d’une obligation vaccinale.
Les maladies ciblées sont, pour reprendre les mots de la Cour et du gouvernement tchèque, « neuf maladies bien connues de la médecine », pour lesquelles existe un très large et solide consensus scientifique quant à l’efficacité et l’innocuité de la vaccination (rougeole, oreillons, tétanos…).
- Retrouvez l'intégralité de cet article écrit par Frédérique Berrod, professeure de droit public, Sciences Po Strasbourg – Université de Strasbourg et Pierrick Bruyas, doctorant en droit de l'Union européenne, membre du Centre d'études internationales et européennes sur theconversation.com